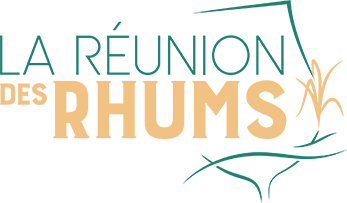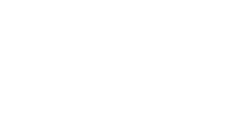Sur l’île de La Réunion, la canne à sucre n’est pas qu’une plante : c’est une véritable épopée. Et avec elle, le rhum est devenu une expression du savoir-faire réunionnais. De la distillation artisanale du fangourin aux prestigieuses cuvées d’aujourd’hui, l’histoire du rhum à La Réunion raconte trois siècles d’audace, d’innovation et de passion.
Les débuts : canne, fermentation et premiers alcools
Bien avant que le sucre ne devienne l’obsession des colons, les premiers habitants de l’île Bourbon (ancien nom de l’île de La Réunion) expérimentaient la fermentation du jus de canne ou de ses résidus. On parlait alors de fangourin, une boisson artisanale locale.
C’est en 1704 que l’on retrouve trace du premier alambic documenté — utilisé pour distiller un alcool de pur jus de canne appelé « arack ». À l’époque, cette production restait modeste, souvent pour un usage personnel ou régional.
Le XIXᵉ siècle : le rhum se structure autour de la mélasse
Avec le développement de l’industrie sucrière, la majeure partie de la production de cannes était destinée au sucre. Cela laissait comme résidu la mélasse, matière première idéale pour distiller un rhum de sucrerie. C’est la transition majeure qui transforme durablement le panorama du rhum réunionnais.
En 1815, Charles Panon-Desbassayns lance ce qui est souvent considéré comme la première distillerie moderne sur l’île. Ce moment marque une bifurcation : la distillation (et donc le rhum) devient progressivement un enjeu industriel et non plus seulement domestique
Mais cette montée en puissance interpelle l’administration coloniale. En 1818, on instaure la Ferme des Guildives, entité chargée du monopole de fabrication et de vente des alcools de canne (rhum, arack). Ce dispositif entraîne des résistances, et des circuits clandestins apparaissent. Le monopole est aboli en 1831, puis repris en partie et finalement supprimé en 1846.
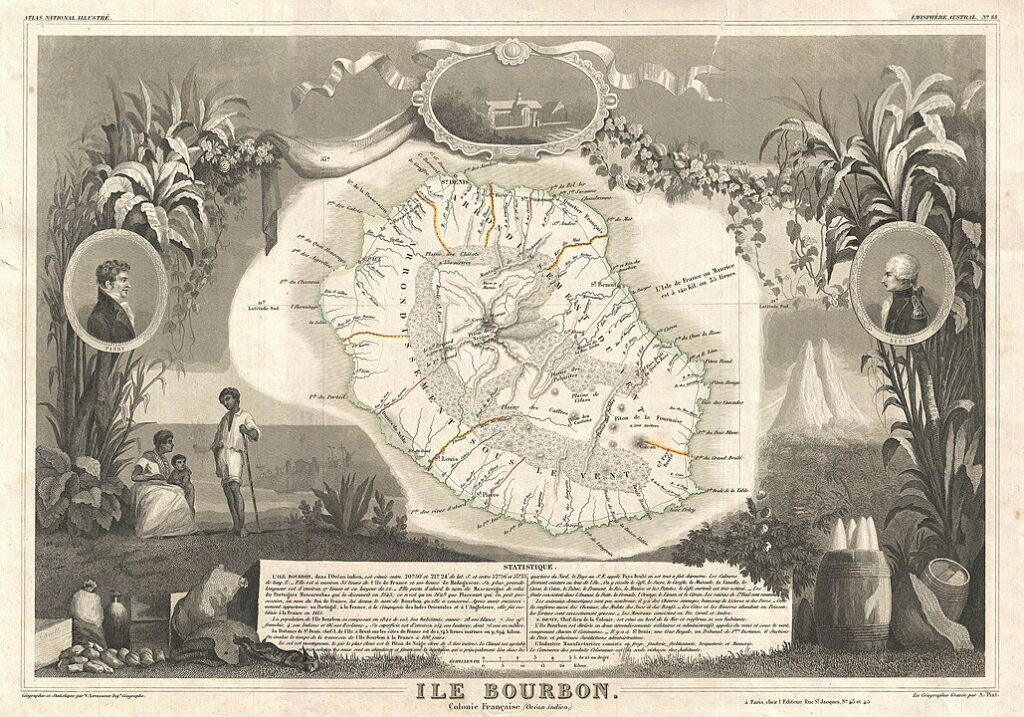
Les grandes maisons et temps forts
C’est dans ce contexte que voit le jour la distillerie Isautier, en 1845, fondée par les frères Charles et Louis Isautier. Jusqu’à aujourd’hui, elle demeure l’une des plus anciennes maisons de rhum en activité à La Réunion.
Parallèlement, d’autres acteurs s’implantent. La distillerie Rivière du Mât voit le jour en 1886, dans l’est de l’île. Elle s’appuie sur la mélasse fournie par les usines sucrières du Gol et de Bois Rouge. La distillerie Savanna est quant à elle créée en 1870, sur un site initial de sucrerie à Saint-Paul, avant d’être déplacée vers Bois Rouge en 1992 pour moderniser ses installations. Fondée en 1907, l’entreprise J. Chatel est à l’origine une distillerie implantée au cœur du chef-lieu à Saint-Denis: au fil du temps, elle deviendra une liquoristerie réputée pour ses rhums aromatisés, ses arrangés et ses punchs.
Sous la pression de l’administration française qui veut que le rhum soit désormais distribué en bouteilles et non plus en vrac comme c’était jusque-là la coutume, les producteurs se rassemblent et créent un GIE, groupement d’intérêt économique en 1972. D’abord sans nom, ce rhum sera baptisé au fil du temps «Charrette» par les consommateurs à cause du logo sur son étiquette
Du XXᵉ siècle au présent : crises, renouveau & label
Le XXᵉ siècle est marqué par des bouleversements profonds. Le déclin du sucre, les fluctuations économiques, les fermetures d’usines sucrières : toutes ces variables affectent directement la disponibilité de mélasse et la viabilité des distilleries.

Pour résister, les distilleries adaptent leur stratégie, en diversifiant les gammes, en investissant dans le vieillissement, en mettant en valeur l’identité locale. C’est dans cette dynamique qu’en 2015 est accordée l’IG (pour Indication Géographique) « Rhum de La Réunion », légitimant une reconnaissance officielle du terroir réunionnais.
Plus récemment, en 2024, le Syndicat des producteurs de rhum de La Réunion (SPRR) et la Fédération interprofessionnelle des alcools de canne de La Réunion (FIACRE) fusionnent pour donner naissance à La Réunion des Rhums, visant à renforcer la promotion et l’exportation des rhums réunionnais.
Héritage & identité : au-delà du spiritueux
Au-delà de son rôle économique, le rhum fait partie de la culture réunionnaise en étant présent dans la musique, la littérature et les traditions de l’île. Le rhum arrangé, par exemple, longtemps perçu comme élixir personnel, est devenu une expression vivante du patrimoine créole. Le musée La Saga du Rhum, créé en 2008 sur le site de la distillerie Isautier, est aujourd’hui le dépositaire de cette mémoire vivante, offrant aux visiteurs une plongée dans le lien entre l’île et son “élixir de canne”.
Les sols volcaniques, le climat tropical, les micro-terroirs contribuent aussi à l’expression aromatique unique des rhums réunionnais. Ces caractéristiques naturelles fusionnent avec un héritage technique — fermentation, distillation, vieillissement — pour dessiner une identité qui ne cesse de se réinventer.
Regards vers l’avenir
L’histoire du rhum à La Réunion est une histoire de résilience et de métamorphoses. D’un simple fangourin domestique aux cuvées primées et à l’IG, le voyage est riche d’enseignements : adaptation aux contraintes techniques, stratégie collective, affirmation identitaire. Aujourd’hui, les producteurs réunionnais se trouvent face à de nouveaux défis — durabilité, export, innovation —. Cet enracinement historique est une force qu’il faut cultiver pour que le rhum réunionnais rayonne davantage encore, non seulement comme boisson, mais comme patrimoine vivant.